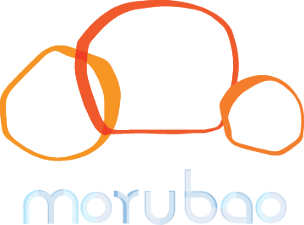Les Cultures Afro-Cubaines
Articles rédigés par Patrice Banchereau
Les cultures afro-cubaines, que l’on qualifie à Cuba de “folkloriques” et en Occident de “traditionnelles” furent jusqu’à la fin du XIXe siècle celles des esclaves, puis au XXe siècle celles de leurs descendants.
Elles sont aujourd’hui celles de tous les Cubains qu’ils soient noirs, blancs ou métis. On peut les qualifier de “créoles” tant elles se sont transformées, séparées de la matrice africaine, et sont devenues rapidement spécifiquement cubaines.
Le terme”afro-cubain” peut prêter à confusion, puisqu’aux USA (et par la suite en Europe) on l’a utilisé – et on l’utilise encore de manière erronée -pour qualifier les musiques “blanches” de Cuba, Son, Charanga et toutes leurs déclinaisons qui donneront naissance dans les années 1970 à la”Salsa” qui est de toute la Caraïbe et sans doute née à NewYork, elle aussi de mélanges.
Dans la musique afro-cubaine point d’instruments à cordes ni à vent, ni guitares, ni pianos, ni cuivres, ni contrebasses:
- de la percussion (principalement des tambours)
- du chant
- de la danse
Ces trois éléments sont indissociables et d’égale importance.
Si on distingue dans la grande île de Cuba environ 100 styles de musique populaire (‘blanche’), on trouve autant de variantes des musiques afro-cubaines, et il serait vain de les citer toutes ici.
Certaines ont disparu, d’autres sont en voie de disparition ou ne se maintiennent que dans certaines villes ou parties de l’île. D’autres sont très vivantes et ne cessent de se transformer, tant les musiciens inventent de nouvelles façons de jouer.
Les plus pratiquées sont généralement associées à des pratiques religieuses venues d’Afrique, aujourd’hui très répandues, officielles et (enfin) prises au sérieux par les instances gouvernementales.
Certaines religions mélangent plusieurs influences, dont certaines issues de la culture religieuse -sinon spirituelle – occidentale. On pratique encore plusieurs langues africaines dans les différentes religions afro-cubaines, parfois l’espagnol dans différentes proportions, et même de la langue créole haitienne dans laquelle on reconnaitra beaucoup de mots français.
Il n’est pas rare que les Cubains pratiquent plusieurs religions en même temps. Certains considèreront que “c’est comme pour la télévision: plus on a de chaînes, plus on a de moyens de communication(spirituelle)”.
Comme dans les sociétés africaines, on s’occupe d’abord de son bien-être spirituel qui permet de mieux vivre et de mieux apprendre à vivre, en devenant un nouvel individu, plus accompli (et donc plus respectable, plus en harmonie avec la société et avec lui-même et les siens).
Accéder à un statut élevé d’initié religieux – ou de musicien de rituels – peut même devenir une activité professionnelle, principale ou secondaire.
Si aux USA on vante les origines africaines du blues et du jazz, alors que l’on n’y trouve ni instrument, ni tradition religieuse, ni aucun élément de langue africaine, c’est bien parce que la répression des traditions culturelles des esclaves étaient totales. Les instruments des esclaves aux USA étaient… le violon et le banjo!
En fait, dans les colonies protestantes d’Amérique la répression était beaucoup plus grande que dans les colonies catholiques. C’est pour cela que dans les Antilles espagnoles, françaises, et au Brésil (colonie portugaise) on trouve encore des langues, des tambours et des cultes venus d’Afrique.
Des structures associatives pour les esclaves furent très tôt créées, appelées à Cuba “Cabildos” (dès1568).
Ces institutions d’entr’aide où les esclaves régissaient tout, et se regroupaient par “nations” n’ont pas toujours eu la vie facile, surtout à l’époque où les USA gouvernaient Cuba en sous-main. Mais c’est en grande partie grâce à ces institutions coloniales espagnoles que les esclaves purent maintenir leurs cultes, et donc leurs langues, leur musique et leurs danses.

1. Les cultes yoruba
Le XIXe siècle vit l’arrivée à Cuba d’un nombre croissant d’esclaves yoruba, dans les quatre provinces de l’ouest de l’île, principalement dans celles de LaHavane et de Matanzas. Les Yoruba sont originaires du quart sud ouest du Nigeria, voire de certaines parties du Bénin et même du Togo. Ils possédaient des traditions culturelles et artistiques parmi les plus fascinantes du continent africain.
Ils furent longtemps connus à Cuba sous le nom de Lukumí. Sur les anciennes cartes d’Afrique on trouve parfois le nom de Ulkumi ou Ulkami. Selon certaines sources l’expression “olukumi”, signifierait “mon ami”. Durant l’époque coloniale, la religion des Lukumí engendra, au contact du catholicisme, un culte appelé “Regla de Ocha” ou plus péjorativement “Santería” (la”Sainterie”) dans lequel certaines divinités originelles ont été associées à des Saint catholiques, parfois de manière libre, parfois contraints et forcés par l’administration coloniale.
Le panthéon yoruba comporte jusqu’à une centaine de divinités appelés Orichas (ou”Ochas”), dont une vingtaine de divinités plus importantes. De nombreuses légendes de tradition orale relatent leur histoire, leurs passions et leurs exploits, tant ils sont semblables aux humains. Comme les dieux grecs de l’Olympe, on les distingue par leurs pouvoirs naturels ou surnaturels, leurs symboles ou “attributs”, leur nourriture, leurs jours de la semaine ou de l’année (selon à la fois les calendriers africains et catholiques), leurs couleurs, leur musique, leurs prières, leurs danses et leurs chants spécifiques. Chaque initié, “fils”ou”fille” d’un Oricha bénéficie de sa protection et portera un ou des colliers (et bracelets) de perles lui correspondant. L’Oricha n’est pas choisi par l’initié mais par les instances religieuses habilitées à consulter les oracles. Une religion séparée – la Regla de Ifá -avec ses prêtres- devins est également fondamentale et régit en quelque sorte les marches à suivre, dictées par les Orichas eux-mêmes. Mais la Regla de Ocha possède également ses propres formes de divination, considérées comme moins importantes hiérarchiquement qu’Ifá.
Communiquant également par le biais de la transe de possesion, que seuls les initiés peuvent atteindre, les Orichas dispensent messages, bienfaits ou punitions aux membres de la société religieuse ou à toute personne en contact avec celle-ci.
Les adeptes de la religion yoruba ont également un ou des esprits individuels qui sont souvent ceux des ancêtres, ou des parents disparus.
- Olofí ou Olodumare, Dieu Suprême, est le Créateur du Monde, et les Orishas ou Santos servent d’intermédiaires entre lui et les hommes. Parmi ceux-ci:
- Eleguá, divinité de la destinée, présents aux carrefours et sur les chemins. Il ouvre la voie aux humains et est parfois associé au Niño de Atocha (l’Enfant-Saint d’Antioche), à Saint Antoine de Padoue ou à l’AnimaSola (l’Âme Solitaire du Purgatoire).
- Ogún, divinité des métaux, guerrier et forgeron, associé à Saint Pierre, ou SanPablo, Saint Jean Baptiste, l’Archange Saint Michel, ou l’Archange Saint Raphaël.
- Ochosi, divinité de la chasse, associé à Saint Norbert;
- Osun, messager d’Obatalá, divinité guerrière associée à Saint Joseph ou San Ramón;
- Inle, dieu-pêcheur, doué aussi de pouvoirs de guérison, associé à l’Archange Saint Raphael;
- Babalú Ayé, divinité des maladies, associé à Saint Lazare, il correspond également à Asoyí (divinité “arará”), à Kobayende (divinité conga) et à Yerbe (divinité ganga-mandingue);
- Oricha Oko, agriculteur, associé à San Isidro Labrador;
- Osáin, herboriste et guérisseur, possède le Secret des plantes. On l’associe généralement à Saint Sylvestre. Ses prêtres, les Osainistes, sont chargés de cueillir et préparer les plantes pour de nombreuses utilisations.
- les Ibeyi (Taebo et Kainde), jumeaux mythiques yoruba associés à Saint Cosme et Saint Damien;
- Agayú, le géant-volcan, père de Changó, associé à Saint Christophe, patron de La Havane;
- Changó, divinité de la musique (et donc des tambours), de la foudre et de la virilite, associé à Sainte Barbe, il correspond également au Hebbioso arará, au Siete Rayos congo et au Mamba mandingue;
- Obatalá, roi des Orichas et divinité de la paix, associé à la Virgen de las Mercedes;
- Oduduá, ancêtre des yoruba, associé à San Manuel.
- Obba, une des épouses de Changó, incarnant la fidélite conjugale et associée à Sainte Rita;
- Yeggüá, est en relation avec les morts, et est associée à Nuestra Señora de los Desamparados, ou à la Virgen de los Dolores;
- Oyá, qui est en Afrique le fleuve Niger, déesse des vents et des tempêtes, autre femme de Changó, associée à la Virgen de la Candelaria, ou à la Virgén delCarmén, ou encore à Sainte Therèse de l’Enfant Jésus.
- Yemayá, déesse de la maternite et de la mer, associée à la Virgen de Regla, mère de beaucoup d’Orichas;
- Ochún, Oricha des rivières et de l’amour, associé à la Vierge de la Caridad del Cobre, patronne métisse de Cuba;
- Orula, divinité de l’oracle, associé à Saint Francois d’Assise;
Les adeptes possèdent chez eux des autels où leur Oricha est physiquement présent, dans un otán (pierre consacrée) placée dans un réceptacle (soupière, chaudron, coffret,plat en terre cuite, etc selon lesOrichas) et entouré d’autres objets rituels symboliques. On y dépose des offrandes de nourriture, boisson, bougie, tabac, etc…
Chaque adepte ayant atteint au bout de quelques années le grade de Santero (au milieu de l’échelle des initiations) pourra permettre à son Oricha d’habiter son corps via la transe de possession dans les cérémonies publiques nommées “toque de Santo”, “tambor” ou “fiesta de Ocha”.
Il existe plusieurs catégories de “toques” yoruba: de batá, de güiro, ou de bembé.
Les toques de Santo sont généralement accompagnés par trois tambours batá, au départ dans les villes puis dans les campagnes, et aujourd”hui dans tout Cuba.
Les toques de güiro sont accompagnés par un ou deux tambours (aujourd’hui des congas), une guataca (lame de houe) servant de cloche et deux ou trois chekerés (calebasses munies de filets de perles, secoués et frappés), d’abord à la campagne puis à la ville et aujourd’hui également dans tout Cuba.
Les toques de bembé, avec de deux à quatre tambours spécifiques (de bembé), parfois frappés avec des baguettes, parfois à mains nues, et une cloche. Il existe différentes formes de güiro et de bembé selon les régions de l’île. De même, deux grands styles originels de jeu existent sur les tambours batá, celui de LaHavane et celui de Matanzas, et les deux se sont répandus dans l’île.
Ces pratiques rituelles yoruba très populaires à Cuba, avec leurs musiques et danses, se sont également exportées hors de l’île, aux USA, au Venezuela, au Mexique, à PortoRico, voire au Brésil, en Europe, etc…
Les tambours, les chants et la danse honorent, invoquent et appellent les Orichas et favorisent la transe de possession, phénomène courant reconnu (mais non expliqué) par la science. On loue, on formule des demandes, on remercie (et parfois on provoque en les insultant) les Orichas, afin de résoudre un problème, pour des funérailles, pour les esprits des morts et lors de certaines processions catholiques.
Les batá sont les tambours de Changó, mais on les joue pour toutes les divinités. Bimembranophones (deux peaux de tailles différentes) et en forme de sablier, ils sont souvent en bois de cèdre avec des peaux de chevreau (ou parfois de cerf). Posés horizontalement sur les genoux, ils sont frappés avec les mains nues (parfois à Matanzas avec un morceau de cuir sur la petite peau). La peau la plus large est l’enú (la bouche), la plus petite le chachá.
Ils consistent par ordre décroissant en:
- Iyá (‘mère’ en yoruba, qualifiée également de “Mayor”), qui régit les rythmes, et possède une grande liberté d’interprétation, d’enjolivement et d’appels.
- Itótele (ou segundo) qui répond aux appels d’iyá, qui possède une moindre liberté de variations, et
- Onkónkolo (ou omelé, ou kónkolo) est le gardien du tempo et possède lui aussi dans certains cas une liberté de varier.

Chacune des extrémités d’iyá porte une ceinture de grelots (chaworo et chawori) qui enrichissent sa sonorité. L’ensemble des trois batá produit huit sons de hauteurs différentes sur les trois peaux (dix sons dans le style de Matanzas qui se joue avec d’autres techniques). De plus, la fabrication e tla consécration de ces instruments obéit à des rituels précis, et les musiciens subissent une initiation spéciale à Añá, la divinité qui réside en eux. Les chants et les danses de la santería illustrent parfois d’innombrables légendes. Les danses, expressives, mimétiques, variées et codifiées, évoquent la personnalité des Orichas. Celles de Yemayá, par exemple, imitent le mouvement de la mer, vagues, houle, tempête ou tourbilllons. Celles de Changó sont élégantes et viriles, et contiennent les symboliques de la foudre, de la guerre ou de la séduction, voire des attitudes sexuelles. Celles de Babalú Ayé illustrent sa malédiction, son agonie et sa résurrection. Dans celles d’Eleguá, les attitudes caractéristiques illustrent souvent son caractère facétieux. La plupart de ces danses comportent des ondulations partant du bassin et se transmettent au torse, aux bras… Les danseurs une fois en transe, sont revêtus de costumes de cérémonie et des différents attributs, et évoluent devant les tambours.
Depuis les années 1940 des revues ont repris sur scène les musiques et les danses yoruba, souvent de façon anarchique, et immédiatement après la Révolution de 1959 des ensembles folkloriques ont été créés, utilisant parfois la danse contemporaine. Des chorégraphies collectives ont été créées, qui s’inspirent des danses traditionnelles en grande partie individuelles, ainsi que des arrangements musicaux. Certains éléments du domaine de la scène (de “lo artístíco”) ont été repris dans les rituels (a “loreligioso”).
La santería est sans aucun doute la religion la plus pratiquée à Cuba, et s’est vulgarisée aujourd’hui à un tel point que des excès sont parfois constatés, tant les étrangers s’y intéressent. Ces débordements, pour des raisons souvent économiques, donnent lieu à des phénomènes qu’on nomme “Santurismo” ou “Ochatour”.
Les anciens critiquent souvent ces transformations qui dénaturent parfois l’authenticité et l’éthique de la religion yoruba sous ses diverses formes.
2. Le culte Abakuá
On désigne à Cuba sous le nom de Carabalí (déformationde”Calabar”) les esclaves originaires de l’extrême sud du Nigeria (le long de la frontière camerounaise), sur la côte, entre la ville de Old Calabar et le Mont Cameroun. Cette zone où le littoral est essentiellement constitué de mangrove comporte d’innombrables bras de rivières et le principal moyen de transport a longtemps été le canoë. S’il a existé à Cuba de nombreux Cabildos Carabalí, dont il subsiste des traditions dans certaines parties de l’île comme à Matanzas (dans le Bríkamo), à Trinidad (dans certains aspects de la Tonada Trinitaria), et en Oriente (dans les Comparsas Carabalí), la plus célèbre des manifestations de la culture de ces esclaves est une”société à masques” longtemps dite “secrète” (elle n’a plus rien de secret depuis longtemps): la société abakuá, qualifiée péjorativement de “ñañiga“. Cette confrérie fondée en 1936, réservée aux hommes, comparables à la Franc-Maçonnerie, a été la première religion afro-cubaine à intégrer des métis et des blancs, dès 1857 (bien que certains ne considèrent pas tout à fait ses cultes comme une religion à part entière). Ce que l’on appelle à Cuba “abakuá” est en fait le prolongement des sociétés Ékpe et Ngbe du Calabar.

C’est à Regla, village portuaire à l’époque séparé de La Havane, de l’autre côté de la baie que fut créé la première “loge” (ou “potencia”, ou “juego“) abakuá par des membres du cabildo Carabali Apapá Efik. Regla était un endroit où étaient débarqués les esclaves, loin des yeux des habitants de LaHavane, et à Regla vivaient de nombreux esclaves impropres “au service” (malades ou impotents), dans des baraques en bois. Pour avoir des lois internes strictes prévalant sur les lois officielles (pour les membres de laconfrérie), et pour accueillir plus tard en leur sein des bourgeois blancs indépendantistes, la “secte” abakuá, qui ne se superpose pas au cadre légal des Cabildos, fut accusée de nombreux crimes, puis interdite et persécutée.
S’il y a bien eu des Carabalí dans de nombreuses régions de l’île, la confrérie abakuá n’a pu s’implanter qu’à La Havane, Matanzas et Cárdenas (elle-aussi un port, de petite taille, situé à l’est de Matanzas, ceci à cause de lois internes limitant sa propagation.
Aujourd’hui une association abakuá officielle réunit toutes les loges et est reconnue par l’état cubain, qui recense 153 potencias, réunissant 20000 membres, soit environ 3% de la population mâle de Cuba. De nombreux abakuá ont émigrés aux USA, qui organiseront à l’été 2009 une sorte de fête-congrès en Floride. Des contacts ont été récemment renoués, grâce à l’ethnomusicologue américain Ivor Miller, entre les sociétés abakuá et la société Ékpe du Calabar.
Le mythe fondateur d’Abakuá, qui est au centre des cultes, dont il existe plusieurs variantes, relate la légende d`une femme nommée Sikán, originaire de la tribu Efor originelle, probablement située au Cameroun, près de la frontière nigeriane, qui alla chercher de l`eau à la rivière sacrée Odán. Elle y recueillit involontairement Tanze, un poisson surnaturel, messager d’Abasí, le Dieu Suprême. Sikán était peut-être membre d`une société secrète de femmes, et révéla l’existence de Tanze-Ngbe et ses secrets aux hommes de sa tribu, puis à la tribu rivale des Efiks. Son père, le roi Iyambá (dans d’autres versions c’est Mokongo) s`empara de Tanze, dont la voix s’affaiblit, et qui finit par mourir. Nasakó le magicien-sorcier finit par réussir à construire un tambour sacré (Ékue) pour reproduire cette voix et lui restituer sa vigueur. Le sang de Sikán nourrit le tambour sacré. Cette idée d’un pouvoir féminin récupéré par les hommes persiste dans les confréries du Calabar. Les potencias cubaines excluent rigoureusement les femmes et les homosexuels.
Les initiés abakuá se réunissent dans un lieu réservé à eux, le cuarto fambá. Leurs rites sont accompagnés, outre Ékue (tambour à friction) par des percussions, des chants, des tambours symboliques muets à plumeaux, et par les danses sacrées des Íremes masqués, incarnant les nombreux personnages originels de la première société enAfrique et certains esprits de la nature. On peut assister à une partie des manifestations abakuá en dehors du cuarto fambá, à l’intérieur de la cour fermée qui entoure celui-ci. Des processions abakuá traversent, lors d’occasions spéciales, les villes de La Havane, Matanzas et Cárdenas.
Il existe trois types de potencias ou “rame”: Efó, Efí et Orú, et un autre secondaire, Eforí, qui n’existe qu’à La Havane. Les sociétés sont hiérachiquement organisées et chacune comporte de nombreux grades, qui tous ont un rôle et peuvent également revêtir un costume d’Íreme, pour incarner le temps d’une transe de possesion l’ancêtre originel correspondant à leur grade, et rejouer leur rôle historique: Iyambá (chef des potencias efó), Mokongo (chef des potencias efí), Isué (chef Orú), Isunekué (chef Eforí), Empegó, Ekueñón, Enkríkamo, Mosongo, Abasongo, Enkóboro, Eribangando, Enkanima, Nasakó, Moruá Yuansá, Ekumbre, Abasí, Emboko, Embákara, Amañanguí, Aberisun et Aberiñán, Kundiabón, Ibiandí, Enkandemo, Koifán, Moní-fambá, Kofumbre, Moní-bonkó, et Sikán.
La société abakuá a difficilement admis que des groupes folkloriques reprennent sur scène leur art, bien que certains de leurs chants aient été enregistrés dans la musique de Son dès les années 1920. Les groupes de rumba, apparus dans les années 1950, ont très tôt intégré la musique abakuá à leur répertoire. Dès les années 1960 des spectacles folkoriques ont mis en scène les mythes abakuá, ce qui a parfois créé des émeutes. Leurs chants, leurs tambours et leurs danses sont parmi les plus fascinants du folklore afro-cubain.

3. Les cultes Congo
On désigne à Cuba sous le nom de “Congos” divers peuples d`origine bantoue issus de divers pays: Congo Brazzaville, Congo Kinchasa, et Angola. Parlant diverses langues, ils furent principalement répartis dans les zones sucrières de l`ile. Les esclaves congos se livraient à des rites magiques, jetant des sorts à leurs tortionnaires blancs, et le dimanche dans les baraques des plantations où ils logeaient, ils se réunissaient pour chanter et danser au son de leurs tambours. Lydia Cabrera a recensé à Cuba plus de 30 noms de nations congos différentes.
Si les Abakuá et les Yoruba ont longtemps maintenu leurs traditions sacrées pratiquement intactes, les Congos, se sont plus intégrés à la culture dominante. Leurs dialectes à Cuba contiennent de nombreux mots espagnols. Il faut savoir que les esclaves congos furent déportés en Amérique dès le XVI siècle, à cause du monopole qu’avaient à l’époque les Portugais sur le traffic négrier, et à leurs contacts dans ces régions.
Durant l’époque coloniale, les esclaves bantou se soulevèrent plusieurs fois et formèrent des palenques, communautés dissimulées dans des lieux inaccessibles, qui contribuèrent à la préservation de leurs coutumes. Il existe quatre grandes religions congos à Cuba, ou “Règles”:
– la Regla de Palo-Monte
– la Regla Mayombe
– la Regla Briyumba
– la Regla Kimbisa
del Santo Cristo del Buen Viaje, fondée au début du XXe siècle par Andrés Petit, personnage légendaire, grand chef religieux catholique, abakuá, yoruba et congo. Il aurait fondé cette règle, incluant également des cultes yoruba, pour protéger ses adeptes, car c’est lui qui a permis aux blancs de rejoindre la société secrète abakuá à la fin du XIXe siècle, ce qui engendra de nombreuses guerres internes au sein de cette dernière.
Les Congos ont à Cuba des traditions musicales très variées, dont les styles varient énormément d’un côté de l’île à l’autre. Le Kinfuiti, tambour à friction comparable à la cuica brésilienne subsiste encore dans la province de La Havane. La Yuka et ses tambours spécifiques taillés dans des troncs hauts et étroits est jouée à la campagne, elle existait dans quasiment toute l’île, mais subsiste seulement dans les Provinces de Villa Clara et de Pinar del Río. La Makuta avec ses nombreuses variantes et ses nombreuses formes de tambours, présente originellement dans quatre provinces du centre-ouest, n’est plus jouée que les provinces de Villa Clara, Cienfuegos et Sancti Spiritus. Ce sont les tambours ngoma de la makuta qui donneront naissance à la conga ou tumbadora, tambour utilisé ensuite dans les carnavals, puis dans la musique populaire urbaine à partir des années 1940. Le Palo est le style le mieux implanté dans l’île, et il est joué dans douze provinces sur quinze.
Les divinités congas sont nombreuses, beaucoup ont des noms espagnols, ce qui prouve l’existence de cultes cubains à part entière, phénomène comparable au Vaudou d’Haiti.
Le Dieu Suprême est Nsambi, citons encore Tiembla Tierra (ou Mama Kengue dans la règle Mayombe), Lucero Mundo, Sarabanda, Siete Rayos (Munalongo en Mayombe, Nkita en Kimbisa), Madre Agua (ou Siete Sayas ou Baluande), Brazo Fuerte (ou Cabo de Guerra), Pandilanga (ou Mpungo), Chola (ou Chola Wengue ou Madre Chola, Mamá Chola ou Madre Agua), Tata Pansuá (ou Pata é Llaga, ou Tata Funde, ou Luleno), Centella Nodki (Yaya Kéngue en Mayombe), Lufo Kuyo, Bután Keye, Kimbisa (ou Mpungo, ou Kabanga), Mama Canata, Ntala y Nsamba (les jumeaux), María Batalla, Paso Fuerte, Buey Suelto, Mariata Congo, Ma Fortuna, Ma Rosario, Zapatico Malakó, Tengue Malo, Mariquilla, Infierno Mundo, Camposanto, Infierno Barre Escoba, Monte Obscuro, Palo Prieto, Tormenta Ndoki Virao, Saca Empeño, Rabo e Nube, Luna Nueva, etc…
4. Le culte Arará
Moins nombreux à Cuba que les Yoruba ou les Congo, les Arará, tirent – pensent certains – leur nom de l’ancienne capitale d’Allada (ou Ardres) et sont originaires de l’ancien royaume du Dahomey, dans le sud de l’actuel Bénin. Un pacte religieux a été signé entre des chefs religieux Yoruba, Arará et Egbado au XIXe siècle, permettant l’association de trois religions.
Le culte arará a quasiment disparu de La Havane, où ne subsistait qu’un seul jeu de tambours consacrés, sous la responsabilité d’Andrés Chacón, récemment décédé.
Avec cet homme s’est éteinte la tradition arará havanaise, et depuis des années déjà pour les cérémonies on faisait venir des musiciens et prêtres de Matanzas, où le culte est encore vivace, notamment dans la région de Jovellanos avec la célèbre famille Baró.
Lors des cérémonies, on utilise trois ou quatre tambours monomembranophones dont la peau est tendue avec des chevilles enfoncées dans le corps des tambours.
Par ordre décroissant: la junga, jouée avec une seule baguette et la main nue, le junguede et le juncito qui sont joués avec deux baguettes de bois tendre. Le quatrieme tambour, optionnel, est le jun. À ces tambours s`ajoute une cloche sans battant, le oggán.
À La Havane on utilisait plutôt les noms de Yonofó, Aplití, Wéwé et Bajo pour ces mêmes tambours.
5. La rumba (yambu, guaguanco, cantos espititual…)
En outre, pour terminer ces explications sur la mouvance afro-cubaine, nous voudrions aussi parler de la rumba qui fait partie intégrante du patrimoine et du folklore afro-cubain et ce sur le fonds des origines de celle-ci.
Par exemple le guaguanco reste fortemment lie à l`afrocubain…
Mais nous y reviendrons dans un autre chapitre